Intense, passionné et passionnant, HELIOGABALE est l’un des groupes les plus éblouissants de la France des nineties. Et pourtant, le quatuor parisien ne se sentait jamais autant à l’aise qu’en marge des flots, hors vague, no wave, diraient les new-yorkais.
En 1992, Klauz Selosse (batteur) et Sasha Andrès (chanteuse) d’un côté, Philippe Thiphaine (guitariste) et Vivian Morrison (aka Viviane, aka Philippe selon l’état civil, bassiste) de l’autre, se trouvent et forment Heliogabale. Après quelques démos, leur premier album « Yolk » voit le jour en 1995, comme une liaison incandescente entre Birthday Party et Sonic Youth. Déjà très affirmé, le style d’Heliogabale va s’affiner de disque en disque, embarquant des touches expressionnistes (« To Pee », 1996) puis embrassant un déconstructionnisme rythmique digne du laboratoire Uzeda avec l’arrivée de Marcel Perrin à la batterie (« The Full Mind is Alone The Clear », 1997). Le groupe se réinvente en 1999 sur l’inquiétant quasi post-rock « Mobile Home », puis disparaît, réapparaît, ressort un disque, re-disparaît ensuite continuellement. S’égrènent ainsi « Diving Rooms » (2004) et « Blood » (2010) jusqu’à leur ultime album, « Ecce Homo » (2018), tout en prose Bashungienne – encore un nouveau territoire.
Vingt-six années racontées par Sasha Andrès, actrice, peintre et surtout, pour ce qui nous regarde, chanteuse d’Heliogabale. Avec une générosité infinie, elle nous offre le récit détaillé de l’intime, des vertiges et des abysses d’un groupe hors du commun. D’une vie.

Noise-moi : Quel est ton parcours avant Héliogabale ?
Sasha Andrès : Enfance et adolescence en Lorraine. Je suis née à Metz, et j’y ai passé les 20 premières années de ma vie. Je ne suis pas issue d’un milieu « artistique », mais mes parents étaient des artistes dans l’âme, ça c’est vrai ! Mais un milieu très, très modeste. Mon père ne gagnait pas sa vie de sa peinture, même si ça a toujours été sa passion. Il était artisan (tapissier) pour payer le loyer et élever ses filles, et ma mère était esthéticienne. Elle s’est passionnée ensuite, quand j’étais ado, pour les travaux de Mézières et Bertherat sur l’énergétique. Elle a enseigné avec la Forge (avec qui j’ai travaillé ensuite pendant 20 ans, j’étais formatrice sur l’accompagnement par les soins énergétiques et la stimulation multisensorielle pour public handicapé), et elle avait ouvert avec ma sœur un institut de soins (où je suis passée aussi après mes études).
Concernant la musique, je chantais tout le temps, mais dans mon coin, sur ma mob entre le lycée et le stade. Personne ne savait que c’était le truc le plus puissant qu’il y avait en moi… J’adorais aller chez les potes qui avaient des instruments de musique, guitare, basse, piano… Ils me laissaient jouer et j’adorais. Je n’étais pas nulle à la basse, et je savais bien que le lien que j’avais à ça allait devenir une part essentielle de ma vie.
Il y avait pas mal de vinyles à la maison et la musique faisait partie du quotidien. Mais ce qui est devenu fondateur, ce sont ces groupes qu’on découvrait sur K7 pirates (qu’on se faisait passer aux bars autour du lycée). Des groupes comme les Boys Next Door puis Birthday Party, Teenage Jesus and the Jerks, Suicide, Rosa Yemen, les Lounge Lizards, les Residents, Siouxsie, Marc Seberg, KaS Product, Minimal Compact, The Cure – leur concert salle Europa (Montigny-lès-Metz, NDLR), octobre 1981, fut une bombe à retardement –, et puis évidemment à peine plus tard, Sonic Youth…
Mais prendre un micro s’est vraiment produit quand je suis partie à Paris.
J’y suis allée pour le théâtre au départ. J’étais en cours avec Isabelle Nanty, elle était cool, mais je n’étais pas alignée avec le monde des comédiens. Ils étaient tous tellement à l’aise avec eux même, c’était pas mon monde, j’étais trop timide et trop punk à la fois. Je sentais bien que je faisais peur… Mes propositions de jeu ou de mise en scène étaient beaucoup plus inspirées par la performance brute que par le théâtre tel qu’il était pratiqué autour de moi.
Non, dès que je réussissais à parler vraiment avec quelqu’un, c’était un musicien.
J’ai rencontré Pronto Rushtonsky (Olivier Rucheton) bassiste de M.K.B[1], et on a commencé à jouer direct. Avec des potes à lui, Jean François et Muriel, et Jean Steph, on s’appelait Mrs Niet, puis ensuite The Torch. On répétait à Luna Rossa, aux Frigos et on jouait surtout dans des squats sur Paris. Puis Klauz Selosse, qui avait aussi joué avec M.K.B, nous a rejoint et ça commençait à être vraiment pas mal…
Octobre 1991, Olivier s’est défenestré depuis la tour des Frigos, j’étais enceinte de lui, tout s’est écroulé, une longue chute qui a duré pas mal d’années. La musique m’a sauvée. La Musique, Heliogabale, la Famille et quelques Amis.
Je devais partir en tournée, une pièce de Tennessee Williams, mise en scène par Brigitte Jaques pour la Comédie Française, dans laquelle je jouais un sombre rôle d’allemande coiffée comme Princesse Leia, quasi muette – et heureusement pour moi vu l’état dans lequel je me mettais chaque jour pour supporter la vie. Klauz était comme mon grand frère et il m’a dit que quand je rentrerai, il serait là. Il m’a fait promettre qu’on commencerait à jouer avec d’autres musiciens et on ferait des putains de sons. Je lui avais dit OK, promis, on va faire ça, bro.
Et on l’a fait, on a rencontré Philippe Thiphaine et Philippe Morrison (Viviane), et dès la première fois où on s’est branchés, il s’est passé un truc vraiment incroyable. Comme si le son était notre langue, pas besoin de parler, ça suffisait qu’on joue… Quatre grands timides qui s’étaient trouvés pour rassembler leurs rages et leurs blessures.
Quatre grands timides qui s’étaient trouvés pour rassembler leurs rages et leurs blessures.
C’est bizarre, parce qu’on a continué de répéter à Luna Rossa pendant pas mal de temps. C’était une sorte d’évidence violente de devoir connecter avec le suicide d’O.
C’est là-bas que sont nés les premiers sons d’Heliogabale, avant même qu’on ait choisi ce nom.
Et Héliogabale fût.
Ouais, avril 92, on s’est rencontrés, deux par deux, donc. Viviane coanimait une émission sur Aligre FM et avait rencontré Philippe autour d’un engouement commun pour les sons distordus. Et j’avais posé quelques mots sur un papier dans un magasin de disques avec un numéro de téléphone. On a répété dans la foulée et joué assez vite live.
Et direct, on s’est connectés.
Pas de cahier des charges, c’est parti à l’instinct, à l’aveugle. On a fait notre premier live très vite, à Lasson. C’est à partir de ce moment-là qu’on a rencontré les Sister Iodine, les Prohibition, One Arm, Ulan Bator, Dragibus, Marcel (Perrin, futur batteur d’Héliogabale, NLDR) et le collectif Ortie, Quentin (Rollet, label Rectangle, NDLR), les Instants Chavirés et tout ça. C’était une toute petite scène en fait, on se retrouvait partout, mais c’était sacrément actif.
On n’avait pas de structure derrière nous. Pour trouver des dates, c’était par des contacts que nous donnaient des potes. On essayait de faire en sorte que les dates et les villes ne soient pas trop éloignées, ce qui était rarement le cas ; et on partait avec nos K7 démos, nos affiches DIY et on louait un camion, c’était ça.
On a alors aussi rencontré Rico Maldoror, qui nous a trouvé quelques contacts et dates. Il était originaire d’Angers, fan de son, ami commun de Virginie Despentes. Virginie, c’est mon amie… on s’est rencontrées avant qu’elle ne soit publiée, via Rico justement, et par la musique. Elle m’avait envoyé son manuscrit avec ces mots « Je t’ai vue en concert, je suis sûre qu’on a des trucs à se dire, voilà un peu à quoi je ressemble… ». Et puis on s’est rencontrées et c’était cool et on restera toujours amies, même si on se voit plus très souvent, on est là, et on le sait, l’une et l’autre. Puis Christophe Feray (Go Get Organized et ensuite Atypeek) qui nous a aidés à sortir notre premier album « Yolk ». On l’avait enregistré avec Ian Burgess à la Black Box.
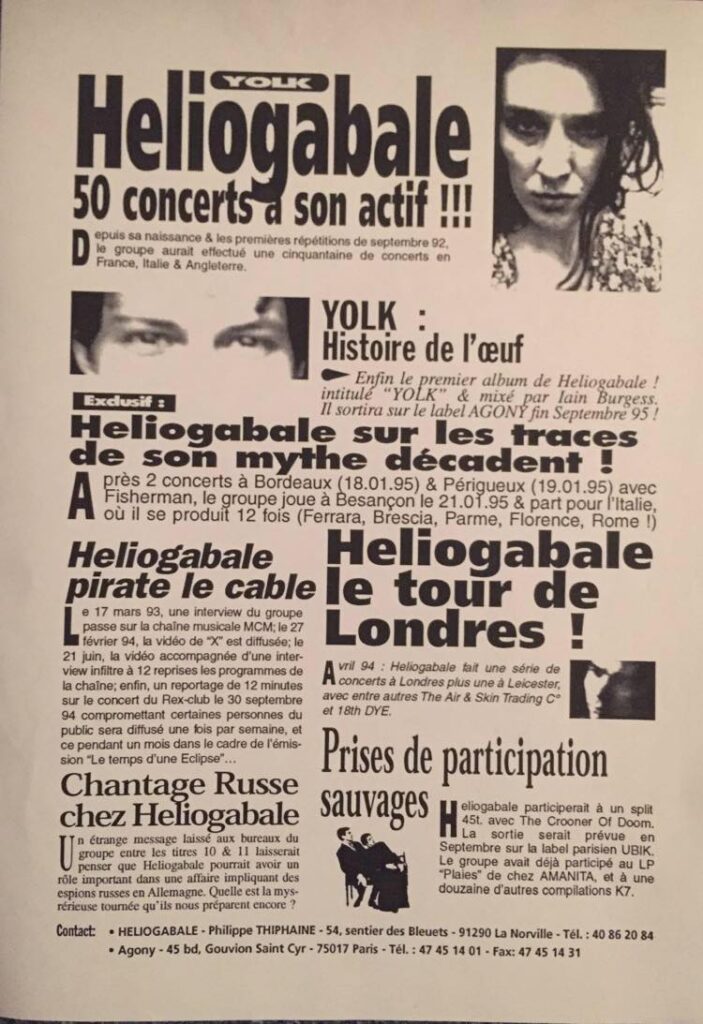
Peux-tu nous parler du collectif PUSH et de votre local commun ?
Avec les frères Laureau de Prohib, on a investi à plusieurs groupes, PUSH (pour Prohibition, Ulan Bator, Sister Iodine et Heliogabale), un grand local au 3ème sous-sol d’un parking à Marx Dormoy (Paris 18e, NDLR). Je crois qu’Ulan Bator a laissé la place à Dragibus assez vite, puis il y a eu aussi les Purr qui sont venus poser leur matos avec nous, et aussi d’autres. Il y a eu plein de monde qui venait répéter dans ce local à un moment, c’était super d’avoir tous notre coin et de pouvoir répéter des nuits entières si le cœur (et le planning) nous en disait.
C’était notre camp de base.
« Yolk » est votre tout premier album et c’est aujourd’hui encore un modèle de puissance et de finesse, d’une subtile abrasivité, d’une grande maturité. Aviez-vous pris conscience de votre potentiel ?
Non, je crois qu’on savait qu’on était traversés par un truc puissant et on aimait ça, le son, se retrouver, jouer, se surprendre et essayer des trucs, se sentir libres de toute attente. C’est l’avantage quand il n’y a pas grand monde qui te connaît, ni qui te suit. On était vraiment incognito, hors cadre, même dans ce milieu noise, en vrai.
Et ce premier disque a-t-il facilement rencontré son public ? Vous a-t-il permis de vivre de votre musique, notamment par le biais de l’intermittence ?
Pour les tournées, je ne sais plus trop dans quel ordre ça s’est fait. Mais on est partis en Angleterre, on dormait dès qu’on revenait sur Londres chez les amis Tjinder (de Cornershop) et Marie. On est allés plusieurs fois en Italie aussi (où pour le coup dans certaines villes, il y avait vraiment une scène et un public noise, grâce à des groupes comme Uzeda), en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Espagne, enfin ce que faisaient tous les groupes de cette scène noise 90. A l’arrache, avec la foi accrochée profond pour passer au-delà de tout ce que ça te demande comme énergie pour enquiller sans structure derrière soi des dates dans des lieux quelquefois improbables où on te paie à peine de quoi foutre de l’essence dans le camion pour repartir le lendemain…
Et on n’a jamais atteint l’intermittence avec le groupe ! Si on vendait un peu de disques, c’était pour aller payer le studio pour le prochain enregistrement. Et niveau merch, on n’était clairement pas intéressés par le concept de trucs chiadés ! Je me souviens avoir peint des slips kangourous à la main ! Et sinon, on a fait une seule fois quelques dizaines de tee-shirts sérigraphiés avec le nom du groupe, et basta.
Et Klauz est parti.
La mort de Klauz… c’est avril 95, entre l’enregistrement et le mixage de « To Pee ».
Ouais ça a été un choc. On perdait un des quatre piliers, le grand frère, celui qui avait donné le nom au groupe, qui avait cru en nous…
Sa fille Crystal a fait une petite série de podcasts (avec une amie à elle qui avait aussi perdu son père à peu près au même moment) qui est super bien… Ça s’appelle « Cherchez le daron »[2] et ça raconte sa quête, le flou pendant des années autour de la vérité sur l’overdose de son père.
Philippe (Thiphaine, guitare) et moi on vivait ensemble et un soir après l’enterrement de Klauz, je sais plus si c’est Marcel ou Viv qui a appelé pour dire qu’il ne fallait pas annuler la date avec Boss Hog (qui était prévue peu après), que Marcel connaissait un peu les morceaux et qu’il pourrait les jouer avec nous super vite… et ça s’est fait comme ça, on a été chopés au vol, extirpés du noir…
Ce concert a été super intense et Marcel a été excellent. Comme il jouait dans pas mal de projets, il n’est pas resté direct avec nous. Il y a eu Ludo Morillon de Prohib’, et aussi Théo Jarrier, des amis précieux, qui nous ont rejoints quelques temps. Puis Marcel est resté définitivement avec Helio à partir de « The Full Mind », qu’on a enregistré à Chicago chez Steve Albini.
– Suite de l’interview dans la 2ème partie –
[1] Messageros Killers Boys. Le groupe est évoqué dans un article dédié aux groupes des années 80.







